On pourrait dire de lui qu’il est le David Cage espagnol. Moins pour son bagout que pour ce qu’il incarne d’une industrie nationale, ce qu’il catalyse à travers sa personne. Lui, c’est Raul Rubio Munarriz, fondateur et ancien directeur général de Mercury Steam (Castlevania : Lords of Shadow), dorénavant à la tête de Tequila Works, le moins indépendant des studios indés espagnols. Après avoir connu un relatif succès d’estime avec le sombre cinematic platformer Deadlight, Raul développe actuellement Rime pour Sony. Il a accepté de revenir pour nous sur son parcours.
Games _ Quel est l’état du jeu vidéo en Espagne ?
Raul Rubio Munarriz _ Par rapport à la France, l’Espagne n’a pas une vraie industrie du jeu vidéo. On n’a pas d’Ubisoft, même pas un Ubisoft Montpellier. Toutes les sociétés de développement sont des petits studios indépendants. De nos jours la scène espagnole s’organise surtout en petites niches autour de ses créateurs, à l’exception de Mercury Steam. C’est un modèle que l’on a connu dans les années 1980 et qui revient en force grâce aux nouvelles plateformes de distribution et à l’accès facilité au consommateur. Avant cela, l’augmentation drastique des budgets avait plutôt eu tendance à reléguer l’Espagne en queue de peloton, on ne pouvait pas vraiment produire de jeux AAA, on n’en avait pas la capacité. Aujourd’hui, les développeurs ibériques peuvent facilement s’attaquer à des sujets plus confidentiels, plus fouillés, et atteindre une large audience, comme Deconstructeam l’a fait avec son thriller moral par exemple (Gods Will Be Watching). Mais ces changements n’ont vraiment affecté que les développeurs : les Espagnols ont toujours été un peuple d’avides joueurs.
« En matière d’organisation et de financement public, l’Espagne est à des années-lumière du Canada »
_ Raul Rubio Munarriz
Existe-t-il une volonté de la part des pouvoirs publics de promouvoir le jeu vidéo ?
Pas vraiment, non. Il existe plusieurs associations à but non lucratif, mais en matière d’organisation et de financement public, nous sommes à des années-lumière du Canada. Mais c’est en train de changer, petit à petit. Cette année le gouvernement a commencé à proposer des financements dans le cadre de leur effort pour dynamiser l’industrie de l’audiovisuel. J’imagine qu’on peut expliquer ce regain d’intérêt par le changement générationnel qui a progressivement lieu dans les institutions. On commence à comprendre notre industrie, à la reconnaître comme une forme artistique qu’il faut soutenir. Rien de comparable à la France néanmoins, puisque pour l’instant les financements publics sont réservés aux entreprises avec plusieurs années d’expérience qui ont déjà fait leurs preuves, et donc qui ont la capacité de rembourser. Avec un peu de temps cet argent sera disponible au plus grand nombre je pense, quand l’investissement dans le jeu vidéo ne sera plus considéré comme un placement à haut risque comme ça peut être le cas aujourd’hui en Espagne.
Vous avez justement participé à la création de Mercury Steam, le plus gros studio de développement espagnol, puis vous l’avez quitté pour fonder Tequila Works. Qu’est-ce qui vous a poussé vers la sortie ?
L’ambition de Mercury Steam était en effet de devenir le plus gros studio AAA espagnol. On voulait prouver qu’il y avait de la place pour ce genre de production en Espagne, et que Pyro Studio [studio à l’origine de la série Commandos, ndlr] n’était pas un accident ou une exception. Cependant après cinq ans dans la boîte, j’ai fini par me sentir inutile.
« Chez Murcury Steam, j’étais assis sur une chaise, payé pour un boulot auquel je ne participais même pas réellement. Ce n’était pas pour ça que je m’étais engagé dans le jeu vidéo »
_ Raul Rubio Munarriz
J’étais le directeur général à l’époque, officiellement j’avais pour mandat de diriger les projets, mais en réalité je n’avais plus vraiment les mains dans la partie créative. Donc en 2007 ou 2008 j’ai proposé à l’entreprise que l’on puisse allouer une partie du budget vers des titres de moindre envergure, afin que je participe à l’effort de guerre. A l’époque Steam était déjà une réalité, et le Xbox Live Arcade faisait ses débuts. Même s’il s’agissait d’une plateforme majoritairement dédiée à l’arcade comme son nom l’indique, Jonathan Blow est arrivé avec Braid et a prouvé qu’on pouvait créer des expériences uniques avec peu de moyens. Le format n’était plus une limitation, je voyais ça comme une opportunité. Malheureusement Mercury Steam n’a pas choisi de suivre cette voie, ils étaient encore très sceptiques sur la viabilité du jeu indépendant et considéraient ça inutile. Mon projet a été refusé et je me suis retrouvé dans une impasse. J’étais assis sur une chaise, payé pour un boulot auquel je ne participais même pas réellement. Ce n’était pas pour ça que je m’étais engagé dans le jeu vidéo, ma vocation c’est de créer. Donc j’ai quitté l’entreprise. Après une petite traversée du désert d’un an, j’ai décidé de bâtir Tequila Works en vendant les parts de Mercury Steam que je possédais. Je ne regrette rien, c’était un nouveau départ.
« En game design, on a tendance à s’étendre, à grandir de façon incontrôlée, comme une tumeur »
_ Raul Rubio Munarriz
Puis vous avez trouvé un incubateur de start-ups prêt à accueillir Tequila Works.
Oui. Au début nous étions deux, et avoir accès à cet incubateur nous a permis de mettre le pied à l’étrier et de fixer nos objectifs. Tout d’abord, les frais d’Internet et d’électricité étaient couverts et le loyer relativement bas, ce qui nous a évité de perdre trop de temps sur la question de l’argent. Ensuite le fait que nous nous situions dans une pépinière d’entreprises sur le point de se lancer boostait drastiquement la créativité, c’était motivant. Enfin, l’atmosphère confidentielle du lieu nous aidait à garder la tête froide vis-à-vis de nos objectifs et de la taille du projet que l’on voulait réaliser. En game design, on a tendance à s’étendre, à grandir de façon incontrôlée, comme une tumeur, et à se retrouver avec un jeu bien plus ambitieux que ce qu’on a réellement la capacité de produire. Ici, le problème ne se posait pas puisque l’environnement nous rappelait constamment que, oui, on était une petite start-up.
Travailler dans un incubateur a également contribué à ce qu’on bénéficie d’un peu plus d’exposition. Des organisations publiques ont commencé à s’intéresser à ce qu’on faisait. Ainsi lorsque l’on a eu besoin de s’établir dans de plus grands bureaux à mesure que l’équipe grandissait, ils nous ont aidé à trouver nos locaux. Ils ont aussi participé à la recherche d’investisseurs, par exemple.
« Travailler dans un environnement où les gens sont d’origine, de sexe, de religion ou de croyance variables, c’est là que réside la clé de la création »
_ Raul Rubio Munarriz
Tequila Works se caractérise par son équipe multiculturelle, quels avantages cela apporte-t-il ?
Je recommande toujours deux choses aux personnes qui participent à cette industrie. Premièrement, travailler à l’étranger. Afin d’expérimenter plusieurs points de vue, des différences de sensibilités, et d’acquérir un peu d’humilité au passage. Ça remet les choses en perspective, on ne se prend plus pour le centre de l’univers, ou on ne croit pas détenir la vérité absolue sur tout. Deuxièmement, travailler dans un environnement où les gens sont d’origine, de sexe, de religion ou de croyance variables. C’est là que réside la clé de la création. Quand tout le monde a les mêmes centres d’intérêt, il est impossible de repousser les barrières du médium, d’éviter de créer quelque chose d’aseptisé. On s’adapte inévitablement au statu quo, on répète des schémas que l’on connait, que l’on sait efficaces.
Le jeu vidéo, ce n’est pas de la cuisine, on ne suit pas une recette. Ou alors si, mais dans ce cas il faut être le chef, celui qui crée de nouveaux plats, qui joue avec votre palais. On ne peut pas se limiter à des structures, à un design préexistant, surtout lorsqu’il s’agit d’un médium que l’on défriche encore. Lorsque les gens viennent de divers horizons, ils apportent avec eux un nouvel éclairage. Pour Deadlight le noyau de l’équipe provenait de studios AAA : Blizzard, Nintendo, Sony. Mais on a aussi embauché des personnes qui n’avaient aucune expérience dans l’industrie du jeu et provenaient par exemple du comics et du cinéma (Pixar notamment). Et elles ont souvent proposé des solutions vitales, qui pouvaient paraître étranges ou incongrues, mais étaient bien plus rapides et efficaces, en plus d’être élégantes. Actuellement, onze pays sont représentés chez Tequila Works : Espagne, Portugal, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Ukraine, Chine et Japon.
« Les jeux ne sont pas une série de mécaniques. Comme dans le « tango à trois » espagnol, trois éléments dansent ensemble : l’art, le design et la technologie »
_ Raul Rubio Munarriz
Comment définiriez-vous la ligne de votre studio ?
Je suis designer de formation, mais pour moi les jeux ne sont pas une série de mécaniques. Ce fut peut-être vrai un temps, mais maintenant il s’agit plus d’une question de balance, voire de métissage, à l’image de ce qu’on appelle en Espagne le Tango a Tres (tango à trois) : trois éléments dansent ensemble, l’art, le design et la technologie. Et comme pour la danse, il faut qu’il y ait une harmonie, un dialogue qui s’installe entre ces composantes, afin de créer une expérience qui soit porteuse d’émotions. Comme pour le tango, on prend part au jeu vidéo, on n’est pas spectateur, on interagit en permanence, et le moindre accroc ou mauvais pas ruine l’ensemble de la prestation.
Pour Deadlight, votre premier jeu, Microsoft a influencé le résultat final, transformant le personnage principal en bon père de famille alors qu’il s’agissait en réalité d’un psychopathe meurtrier. Le regrettez-vous ?
Oui. Mais en tant qu’entreprise, je crois comprendre la raison qui les a poussés à faire ce changement.
Pour nous, la cible de joueurs que l’on cherche à atteindre est la clé de voûte de nos projets. Pour Deadlight, il s’agissait des personnes qui ont grandi dans les années 1970 ou au début des années 1980, habitués à des histoires underground comme celles de Richard Corben ou Moebius, ces contes dystopiques angoissants où l’on avait l’impression que personne ne pouvait s’en sortir. On voulait faire en sorte que notre cible puisse comprendre qu’elle se déplace et vit dans un monde où tout était perdu d’avance, où une guerre contre les zombies se déroule, dans laquelle on n’incarne ni le héros, ni le anti-héros, mais bien l’antagoniste. Au départ, Microsoft semblait d’accord, et je pense qu’ils avaient compris où on voulait en venir. Cependant lorsque nous sommes entrés dans le Summer of Arcade, une période de promotion importante pour Microsoft, ils ont décidé que l’histoire était trop sinistre pour le public américain, et donc qu’il fallait transformer le protagoniste principal en père de famille. Cela s’est passé environ trois mois avant la sortie.
« Quand nous sommes entrés dans le Summer of Arcade, Microsoft a décidé que l’histoire de Deadlight était trop sinistre pour le public américain, et donc qu’il fallait transformer le protagoniste principal en père de famille »
_ Raul Rubio Munarriz
De notre côté nous avons toujours défendu le fait qu’il s’agissait d’une fiction d’inspiration européenne. Nous insistions sur l’importance cruciale du ton déprimé du récit. Il était capital que le personnage, en comptant sur l’intelligence du joueur, se dévoile petit à petit comme un psychopathe. On avait pris soin de laisser des indices, comme le fait qu’il ne différencie pas humains et zombies, qu’il survive si longtemps seul (parce qu’il tuait tous ceux qu’il rencontrait). Quand le héros fut transformé, ça a chamboulé tout le jeu. Tout ce qu’on avait mis en place, les environnements dépressifs, le journal écrit par un détraqué, les cartes d’identité des serial killers des années 1980, tout cela jurait complétement avec la quête d’un père de famille pour retrouver sa femme et sa fille. Du coup on n’a pas pu créer ce déclic chez le joueur comme on l’avait prévu.
Cela a même été complètement contre-productif. Aux Etats-Unis et au Canada, lorsque les gens ont vu que l’on pouvait collecter des cartes d’identité de tueurs en série, on a reproché au jeu de banaliser ou d’enjoliver le meurtre. En vérité on essayait de faire tout le contraire, en tentant de produire un discours critique sur l’approche très « jeu vidéo » qui stipule qu’il faut tirer sur tout ce qui bouge. Ce qui revient, dans notre idée initiale, à incarner un psychopathe en pleine folie meurtrière.
« Les joueurs ont perdu ce rapport à la frustration, qui autrefois faisait partie de l’apprentissage des rouages d’un jeu – surtout dans Another World »
_Raul Rubio Munarriz
On vous a également reproché un gameplay un peu daté. Etait-ce vraiment judicieux de s’inspirer d’un genre aussi rigide aujourd’hui que le cinematic platformer ?
Notre référence principale pour Deadlight était Another World. C’était particulièrement compliqué de répliquer une œuvre qui résiste aussi bien au passage du temps. On a fait l’erreur de calquer nos contrôles sur le modèle digital de l’époque alors que maintenant tout le monde est habitué à l’analogique, on aurait sans doute dû actualiser la formule. C’est quelque chose dont on s’est rendu compte trop tard. Mais je pense surtout que le public n’est plus le même. Les gens sont globalement moins tolérants vis-à-vis de ce genre de mécaniques. On a perdu ce rapport à la frustration, qui autrefois faisait partie de l’apprentissage des rouages du jeu (surtout dans Another World), mais qui maintenant semble banni de toute la production. C’est là toute l’importance de savoir trouver le bon équilibre entre risque et récompense dans son game design. Aujourd’hui on fait prendre moins de risques au joueur, et on lui en donne plus. Le ratio n’est plus le même, ce qui témoigne d’un certain assistanat. Les jeunes qui ont pu jouer à Deadlight me regardaient après cinq minutes de jeu en me demandant comment je pouvais aimer ce type de gameplay. Je me sens vieux.
Comme pour Deadlight, on constate dernièrement que les éditeurs veulent de plus en plus coloniser le monde du jeu indépendant en proposant des partenariats ou en accueillant les jeux sur leurs plateformes contre une exclusivité. Cet enthousiasme ne cache-t-il pas une menace pour la créativité du secteur indépendant, accaparé par les gros éditeurs ?
Je ne pense pas qu’il y ait de réelle menace. On est en train de migrer progressivement vers un modèle où le créateur s’adresse directement au consommateur, ce qui rend forcément les éditeurs superflus. Cela apporte un effet positif que l’on a déjà pu commencer à constater : le contrôle créatif est en train de changer de main – ceux qui ont l’argent le perdent au profit de ceux qui ont les idées.
« On n’accepte pas les commandes d’éditeur, mais ce qu’on pourrait éventuellement accepter, ce serait d’appliquer notre sensibilité à une franchise »
_Raul Rubio Munarriz
Après votre mauvaise expérience sur Deadlight, accepteriez-vous un contrat s’il n’implique pas un contrôle total sur la partie créative ?
On n’accepte pas les commandes d’éditeur, mais ce qu’on pourrait éventuellement accepter, ce serait d’appliquer notre sensibilité à une franchise. Il y a dix ans, peu de réalisateurs auraient accepté de signer un contrat pour tourner un film Marvel parce que cela aurait été formaté et très cadré, mais maintenant chaque réalisateur a la liberté d’y appliquer sa propre patte créative. On choisit ce que l’on fait parce qu’on le considère digne d’être réalisé, et que l’on peut apporter quelque chose au projet. Il faut que ce soit pertinent.


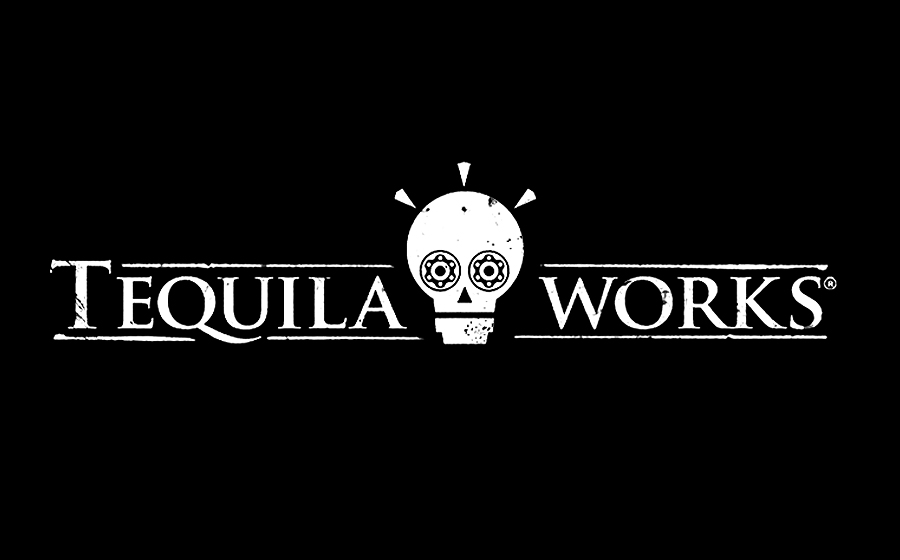
















No Comments